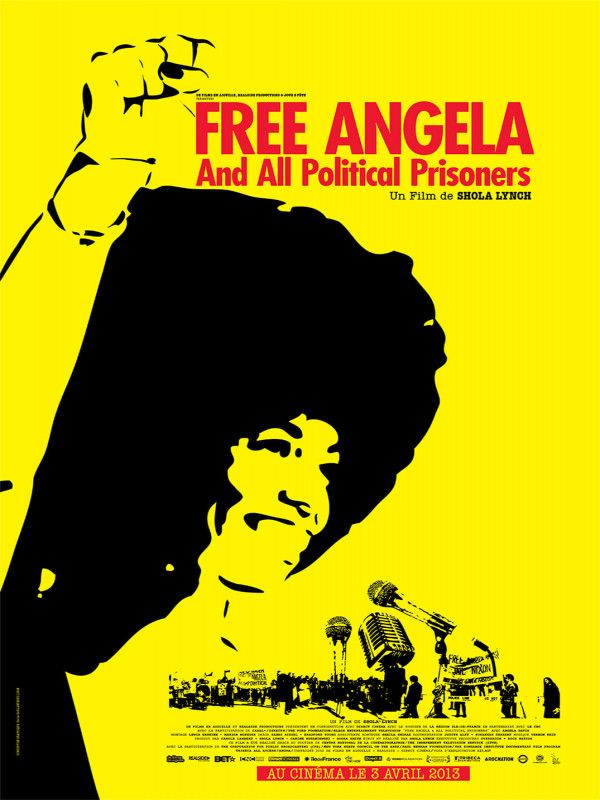Palme d'or : La Vie d'Adèle d'Abdellatif Kechiche [France]
Sans surprise, La Vie d'Adèle ayant été qualifié de chef d'oeuvre par absolument toute la presse devait remporter la récompense suprême. Le réalisateur de L'esquive (2005) et de La Graine et le mulet (2007) livre ici une adaptation de Bd (Le Bleu est une couleur chaude) de plus de trois heures avec deux actrices époustouflantes (Léa Seydoux et la nouvelle Adèle Exarchopoulos). A découvrir en salle le 9 octobre 2013.
Grand Prix : Inside Llewys Davis de Joel et Ethan Coen [Etats-Unis]
Le film des Coen était lui aussi attendu au palmarès, mais non pour un aussi grand prix. C'est donc avec plaisir que nous voyons le Jury récompenser ces deux génies, déjà palmés en 1991 pour Barton Fink. Inside Llewyn Davis raconte une semaine de la vie d'un chanteur folk des années 60 dans la ville de New York. En salle le 6 novembre 2013.
Prix du Jury : Tel père, tel fils de Hirokazu Kore-eda [Japon]
Cinéaste japonais connu en France pour les très remarqués Still Walking (2008) ou I Wish (2012), Kore-eda se démarque par son classicisme, sa mise en scène simple, douce, non agressive et passionnante. Les thèmes abordés par le cinéaste (l'enfance, la famille) ont eux aussi put facilement conquérir le jury, en particulier Steven Spielberg.
Prix de la mise en scène : Héli d'Amat Escalante [Mexique]
Clairement la tâche du palmarès. Haï par une bonne partie de la presse, le film ultra violent du jeune mexicain disciple de Carlos Reygadas (lui même lauréat du prix de la mise en scène l'an dernier avec l'épouvantable Post Tenebras Lux) a semble-t-il convaincu et choqué suffisamment le jury pour lui remettre un prix de cet envergure.
Prix du scénario : A Touch of Sin de Jia Zhangke [Chine]
Attendu au palmarès, prix amplement mérité pour un des plus grand (ou le plus grand) cinéastes chinois en activité. Lion d'or à Venise en 2006 pour Still Life, Jia Zhangke est à la fois cinéaste de fiction et documentaire, combinant parfois les deux polarités et expérimentant sur de nombreux terrains. Un artiste à part entière pouvant facilement prétendre à une palme dans les années à venir.
Prix d'interprétation féminine : Bérénice Béjo dans Le Passé d'Asghar Farhadi [France]
La grande surprise de ce palmarès. Alors que le nom de Léa Seydoux et Adèle Exarchopoulos résonnait à tous les murs du palais des festivals, Bérénice Bejo n'avait pour ainsi dire quasiment jamais été pressentie pour le prix. Le Passé est un film régnant essentiellement par son interprétation et sa direction d'acteurs, exceptionnelle pour un iranien tournant à l'étranger.
Prix d'interprétation masculine : Bruce Dern dans Nebraska d'Alexander Payne [Etats-Unis]
Le premier prix décerné et également l'un des plus surprenant. Bruce Dern (père de Laura Dern) est certes un immense acteur américain, mais mérite-il pour autant ce prestige pour un road movie aux allures assez classiques d'Alexander Payne, petit cinéaste américain populaire ? Nous le saurons en janvier 2014.
Caméra d'or : Ilo ilo d'Anthony Chen [Singapour]
Palme d'or du court métrage : Safe de Moon Byoung-gon [Corée]
Les oubliés
- The Immigrant de James Gray : Cinquième film, quatrième passage sur la croisette, toujours aucune récompense. Cinéaste mal accueilli aux Etats Unis mais très chaleureusement en France, il a réalisé trois grand chef d'oeuvres destinés à entrer dans l'histoire du film noir : The Yards (2000), La Nuit nous appartient (2007), Two Lovers (2008). Cette fois-ci n'était encore une fois pas la bonne, mais nous persistons à croire que le plus grand festival au monde ne peux passer à côté de ce pauvre génie.
- La Grande Bellezza de Paolo Sorrentino : Des rumeurs énoncent que Paolo Sorrentino n'obtiendra jamais de palme. Prix du Jury en 2009 pour Il Divo, ses deux derniers films (This Must Be The Place et La Grande Bellezza) n'auront finalement pas marqués les esprits cannois. Grand cinéaste italien sous estimé, La Grande Bellezza, sorte de Dolce Vita du XXIème siècle a divisé presse et public. Pourquoi bouder devant un tel artiste, s'extériorisant en public et mettant en scène des personnages plus riches que nature ? A découvrir en salle en ce moment même.
- Ma vie avec Liberace de Steven Soderbergh : Annoncé comme le dernier film de Soderbergh et ayant fait pas mal de bruit pour un double prix d'interprétation Matt Damon/Michael Douglas, la deception est grande. A découvrir en salle le 18 septembre.